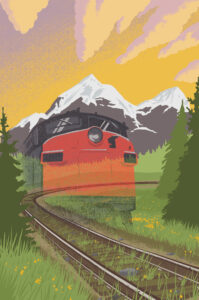L’importance de la vallée de l’Elk comme corridor faunique est reconnue depuis des décennies. Depuis les années 1990, les chercheurs compilent des preuves démontrant que la route et l’habitat local nuisent aux prédateurs de pointe. Pour certains, notamment les grizzlis, cela empêche également un mélange génétique sain entre les populations du nord et du sud. Avec l’essor de l’exploitation minière et forestière, la fréquentation accrue de la région pour les loisirs et l’augmentation de la circulation, le statut de pilier écologique de la région est menacé.
« C’est le dernier et le meilleur corridor », déclare Tony Clevenger, chercheur dont les recherches ont guidé la conception et l’emplacement du célèbre système de passages supérieurs et inférieurs pour la faune du parc national Banff, et l’un des premiers responsables du projet « Reconnecting the Rockies ». « C’est ce qui relie Y2Y. En gros, si on le perd, on perd tout.»
L’impulsion donnée à « Reconnecting the Rockies » remonte à une décennie, et le projet est présenté dans deux documents essentiels. Le premier rapport, publié en 2010 et recommandant des modifications structurelles le long du corridor de la route 3 afin de favoriser la faune et la connectivité, étudiait le tracé depuis Cranbrook, traversant la vallée de l’Elk jusqu’en Alberta, où il quitte les contreforts des Rocheuses près de Lundbreck, à 40 kilomètres à l’est du col du Nid-de-Corbeau. Rédigé par Clevenger et six autres personnes, il identifie les zones prioritaires et recommande des mesures le long de la route à six endroits en Alberta et huit en Colombie-Britannique.
Le deuxième document a été rédigé neuf ans plus tard, lorsque Clevenger, Lamb et Tracy Lee, chef de projet principale à l’Institut Miistakis, un organisme de conservation de Calgary, ont publié une modification au rapport initial portant spécifiquement sur la route 3 en Colombie-Britannique. Ce document incluait des sites d’atténuation prioritaires supplémentaires, en plus de ceux identifiés en 2010, et constitue la base des travaux actuellement en cours.
Dès la publication du premier rapport, les auteurs savaient qu’ils avaient besoin de plus de données sur la mortalité de la faune du côté de la Colombie-Britannique pour élaborer un plan viable pour cette zone. C’est là qu’intervient la science citoyenne. Il a fallu plusieurs années, mais une partie essentielle de la collecte de ces nouvelles informations a débuté début 2016 avec le lancement de RoadWatchBC. Développé conjointement par Miistakis, Yellowstone to Yukon et Wildsight, un réseau de conservation et de développement durable de la région de Kootenay, RoadWatchBC invitait les automobilistes de la vallée de l’Elk sur l’autoroute 3 à consigner leurs observations d’animaux sauvages (animaux tués, blessés ou tentant de traverser) sur une application et un site web. Le programme a été en vigueur jusqu’au début de 2019, et plus de 200 personnes ont soumis des observations. « La science citoyenne était un bon moyen de mobiliser significativement les gens tout en comblant un manque de données », explique Lee.
Batycki de Y2Y ajoute : « Les données du ministère sont largement sous-déclarées, car elles se basent uniquement sur les animaux tués sur la route. Le programme RoadWatchBC a permis aux citoyens de surveiller de plus près les animaux qui traversent en toute sécurité, ceux qui rencontrent des difficultés et ceux qui sont heurtés ou blessés, mais quittant les lieux. »
Outre les données de RoadWatch, l’équipe a également obtenu de nouvelles recherches de la province, ainsi que les résultats d’études de suivi des grizzlis et des wapitis préparées par Lamb, qui terminait alors son doctorat en écologie, étudiant les impacts humains sur les populations de grizzlis, à l’Université de l’Alberta. Avant de rédiger l’amendement, ils ont organisé un autre atelier dans la salle de réunion d’un hôtel de Fernie en mai 2019 afin de partager leurs conclusions et de recueillir leurs commentaires.
Des représentants des communautés locales de chasseurs et de pêcheurs, des entrepreneurs, des élus locaux, des scientifiques et d’autres membres du public étaient présents. Mais la personne la plus importante dans la salle ce jour-là s’est avérée être un homme d’âge moyen discret, à la moustache châtain clair, qui avait parcouru près de 700 kilomètres en voiture depuis Kamloops.
« Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. Et il n’a pas beaucoup parlé. Mais il s’est assis au bout de la table et a tout assimilé », se souvient Batycki. « À la fin de la réunion, je me suis présenté et lui ai dit que nous appréciions vraiment que vous soyez venu de Kamloops. Et il a répondu : “Ça m’intéresse beaucoup.” »
Cet homme était Duane Wells, directeur régional des services environnementaux au sein de la section Ingénierie du ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique. Son équipe est chargée de s’assurer que tous les nouveaux travaux routiers dans le sud de la Colombie-Britannique respectent les normes de protection de la faune et des ressources halieutiques. En général, cela signifie s’assurer que les ponceaux sous les nouvelles routes sont praticables par les poissons et que les autres structures comportent des passages pour les animaux terrestres. En ce qui concerne les rénovations, cependant, jusqu’alors, il avait surtout supervisé l’installation de ponceaux-caissons pour les crapauds de l’Ouest, une espèce menacée. « À une échelle bien plus réduite que lorsqu’il s’agit de grizzlis », dit Wells sèchement.
Aujourd’hui, ses partenaires de l’équipe « Reconnecting the Rockies » utilisent des termes comme « champion absolu », « héros » et « catalyseur » pour décrire Wells et le rôle qu’il a joué dans la concrétisation de leurs projets. Et ce, malgré le fait qu’au début, il ait principalement géré le projet depuis son bureau.
Après la réunion de Fernie, Wells a parcouru lui-même la route de la vallée de l’Elk, notant les ponts et leurs fondations, ainsi que les travaux et équipements nécessaires pour améliorer le passage de la faune. Un mois plus tard, il est retourné rencontrer Teck Resources, qui exploite cinq mines de charbon à ciel ouvert dans la vallée de l’Elk. Sur place, il a demandé à son contact de lui montrer les endroits où les animaux traversent habituellement l’autoroute.
Lors du deuxième site visité, Wells a eu une révélation. « C’était comme : “Oh mon Dieu, c’est parfait !” », dit-il.
Baptisé Alexander-Michel en référence aux deux ruisseaux voisins, il a été désigné comme site de passage prioritaire en 2010. Mais il a fallu un ingénieur des transports pour s’arrêter sur ce tronçon d’autoroute, observer la voie ferrée longeant la route au pied d’un rétrécissement du terrain et identifier l’emplacement idéal pour un viaduc.
Il a immédiatement appelé Batycki, Lee et Randal Macnair, coordinateur de la conservation de la vallée de l’Elk chez Wildsight, pour leur demander s’il pouvait leur expliquer son projet.
« Nous avons retrouvé Duane au col du Nid-de-Corbeau », raconte Batycki. « Nous sommes montés dans nos voitures et il nous a arrêtés à Alexander-Michel en nous disant : “Voici où nous allons installer votre viaduc.” Nous nous sommes regardés sans même pouvoir parler. »